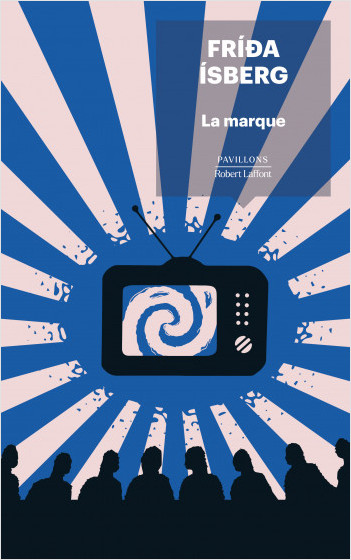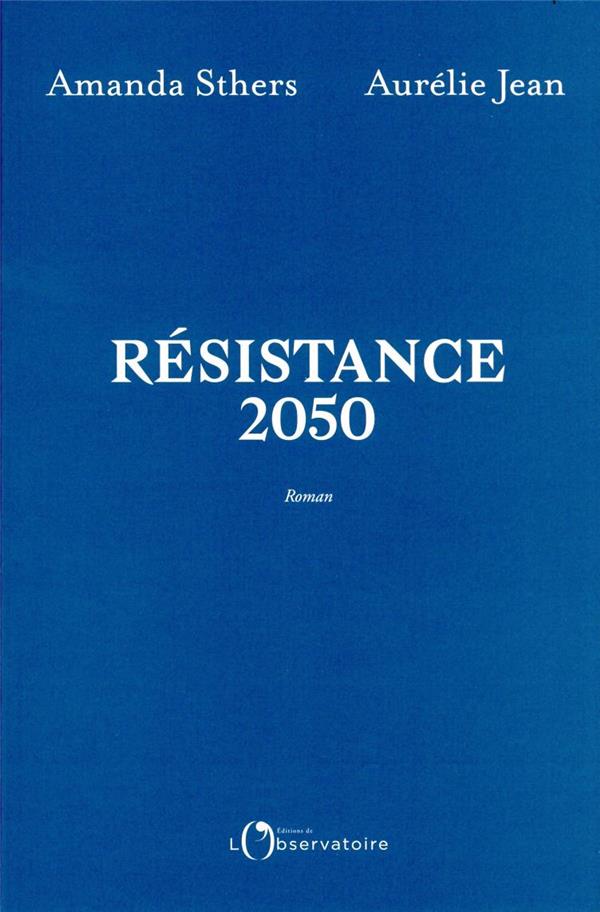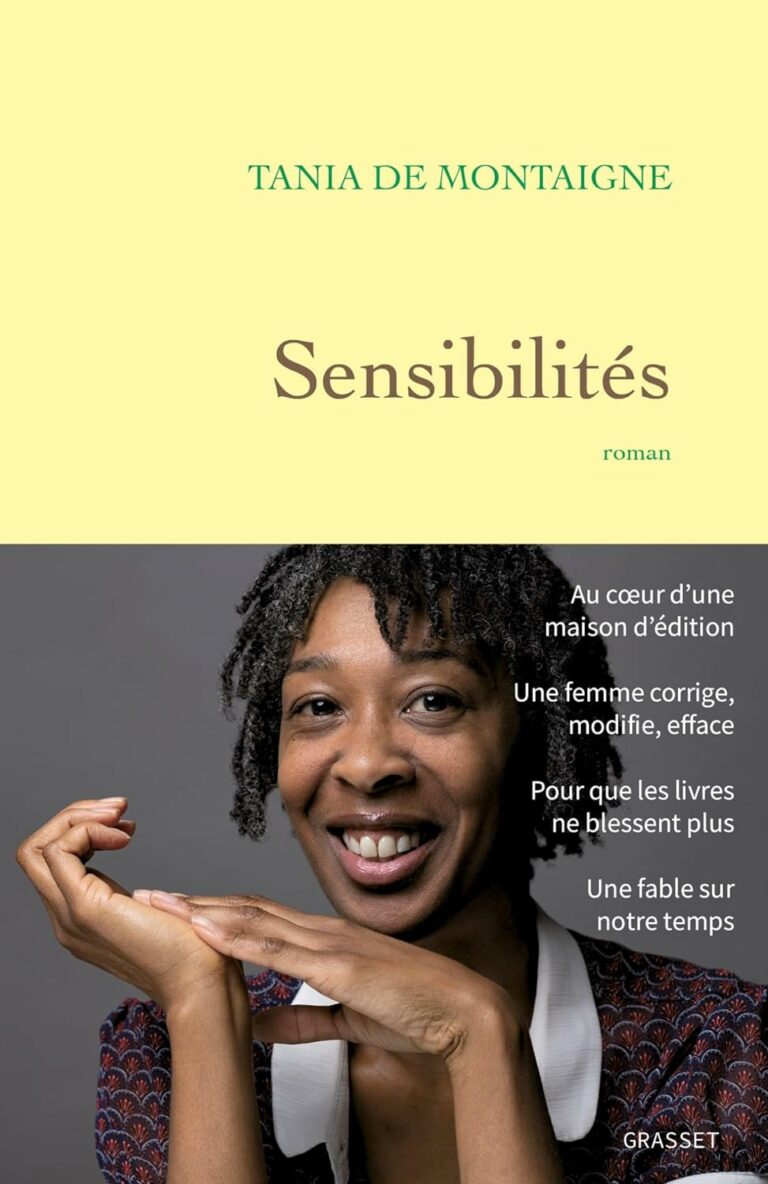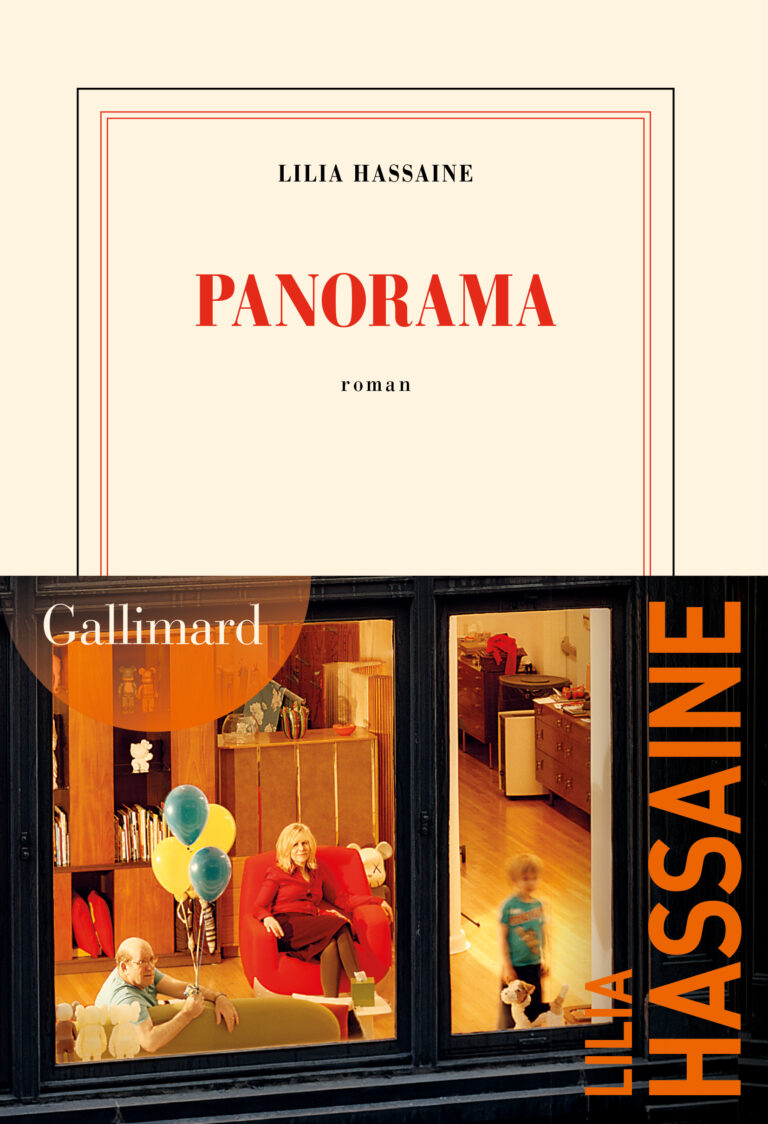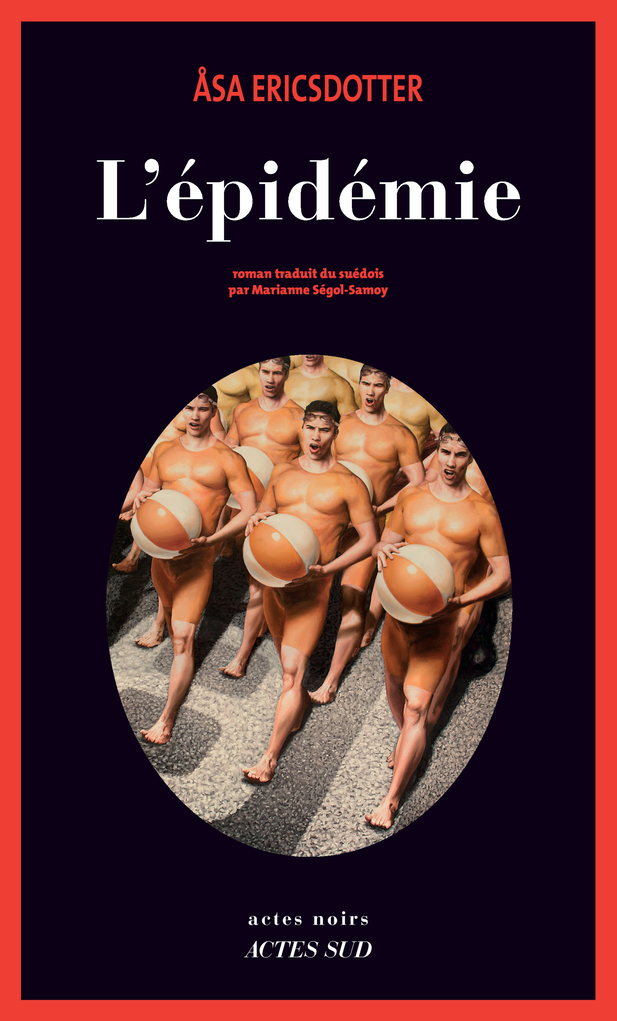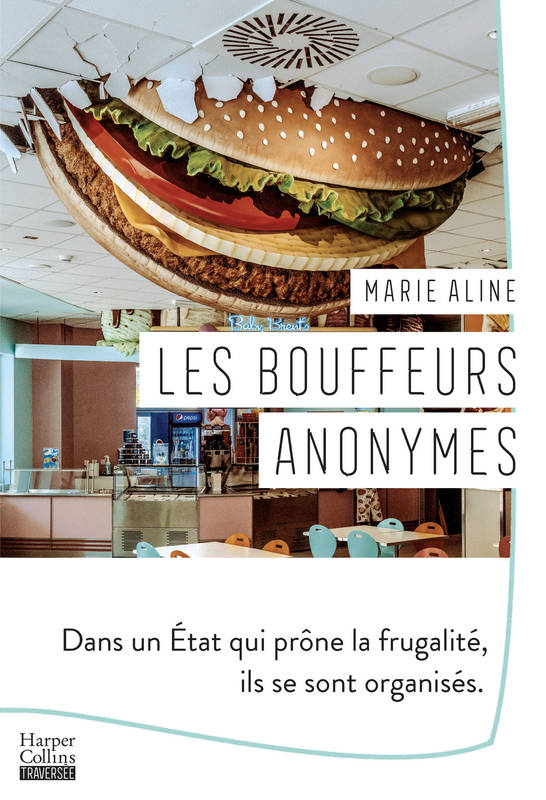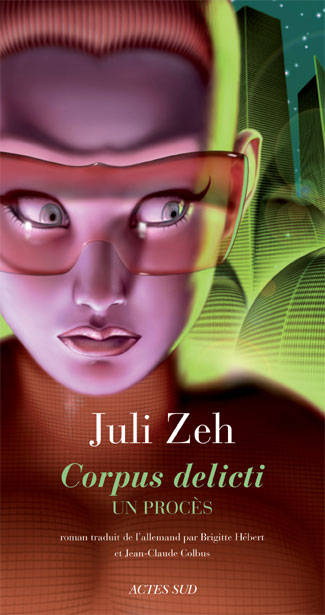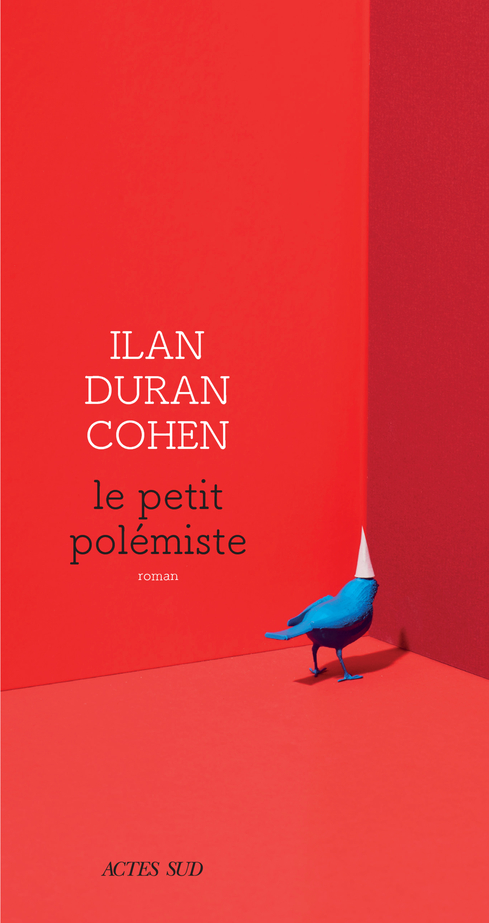Dystopie écrite à quatre mains, celles d'une écrivaine chevronnée et d'une scientifique spécialiste des algorithmes, le roman est ambitieux. Le thème est très actuel. La majorité des individus a en effet choisi de s'équiper d'une "puce cérébrale" qui apporte performances et santé, qui supprime la douleur et anesthésie les angoisses. Face à ce bonheur imposé, certains résistent et défendent la...
LireLA MARQUE | Frida ISBERG
Publié le 22 aout 2023
Dans ce roman islandais, le contrôle social devient un contrôle psychologique. Dans une société restreinte et insulaire, chacun doit prouver sa sociabilité.
Des tests sont conçus pour cela. Vous les réussissez et vous possédez le signe distinctif, la Marque, de votre appartenance au corps social. Vous échouez ou vous le refusez et vous devenez un paria, un exclu et tout vous est retiré (emploi, logement, accès libre à certaines zones, etc…).
L’autrice explore un nouveau type de clivage et de discrimination. Ce n’est plus l’âge, la naissance, la classe sociale, les caractères ethniques, la religion, la richesse, le sexe, les convictions politiques, la santé, l’intelligence, (tous ces critères qui ont inspiré maints récits dystopiques), il s’agit d’un facteur plus flou mais aussi plus global, l’empathie.
Frida Isberg donne le pouvoir aux psychologues. Quand ceux-ci parviennent à faire rendre obligatoires leurs normes de comportement, on peut craindre l’avènement d’un totalitarisme, certes subtil, mais particulièrement implacable.
Le roman » La marque » a été publié en 2021 en Islande, où il a reçu un très bon accueil,
Les éditions Robert Laffont l’ont traduit en 2023 et édité dans leur collection « Pavillons ».
LE CONTEXTE: La marque de l’empathie.
Le Système National de Santé mentale est le pivot de la nouvelle politique. Les psychologues de cette Institution mettent au point une évaluation psychologique chargée de mesurer l’empathie et l’immoralité en constatant si le sujet éprouve un « sentiment de souffrance ou de malaise vis-à-vis de la douleur d’autrui » (page 315) . Pour eux, la corrélation entre le manque d’empathie et la déviance est évidente. Les associaux doivent être traités et médicalisés.
Le test d’empathie est d’abord adopté par le personnel politique qui veut ainsi se justifier et mériter la confiance des électeurs.
Puis le test devient obligatoire pour les représentants des différents pouvoirs y compris médical.
Ensuite un registre public recense les personnes ayant passé positivement le test. Chacun peut ainsi savoir qui a réellement réussi l’évaluation et mérite d’être identifié pour cela.
La « Marque » était née.
Ceux qui échouent ou refusent, s’exilent ou entrent en thérapie.
Les victimes du marquage sont d’abord les jeunes hommes, plus rebelles que les filles. Ils peinent à s’insérer, ainsi un cinquième des garçons de moins de 25 ans ne sont ni scolarisés ni salariés.
Certains lieux, quartiers, immeubles, magasins, entreprises choisissent d’exiger le test. Ils sont alors « marqués » et n’acceptent que ceux qui disposent de ce signe distinctif. Toutefois, même si la pratique du test est très répandue, elle n’est pas généralisée.
Les partisans du marquage, en particulier les « psychologues », envisagent donc que celui-ci devienne obligatoire.
Un référendum est prévu pour trancher ce point crucial.
Le récit décrit l’état de la société alors que l’échéance approche. Il le fait à partir de quelques cas, emblématiques des situations psychologiques et sociales de l’ensemble de la population.
Le roman, polyphonique, choisit donc une structure éclatée, brillante mais peu propice à favoriser la compréhension du texte.
Le message de l’autrice en est quelque peu brouillé.
Pense-t-elle aussi que « la marque n’est pas une punition mais un moyen de prévention » (p100)? Qu’il faut cela pour obtenir « l’optimisation du bien-être général » (p47)?
On n’ose pas l’affirmer.
L’INTRIGUE : Quatre héros emblématiques
Le débat entre les partisans du marquage et les opposants s’incarne dans quatre héros (et leur entourage).
Tout d’abord, OLI, le psychologue qui s’engage en politique pour défendre le test obligatoire pour tous (et tous les ans !). Rigide, il s’oppose à son père, son épouse mais reste inflexible.
Face à lui, trois personnages, déviants ou en souffrance, craignent l’avènement de l’évaluation psychologique généralisée.
Tout d’abord, VETUR, une enseignante fragile qui est traumatisée par le harcèlement exercé par son dernier compagnon, dont elle a toutefois obtenu l’éloignement. Elle vit mal, par ailleurs, l’application du test aux élèves de son école et surtout l’accès aux résultats pour tous les parents.
EYJA, pour sa part, ne se remet pas de son divorce et poursuit, avec agressivité, son ex-mari. Spécialiste de l’analyse financière, elle est licenciée par son employeur et cède à la paranoïa.
Enfin, TRISTAN, le plus représentatif de l’échantillon, est inadapté aux contraintes sociales. Il a abandonné le lycée et fuit sa famille dysfonctionnelle. Il travaille sur le port et commet de nombreux cambriolages.
Il se drogue et éprouve une haine tenace pour OLI, qu’il menace et agresse. Il cherche désespérément à acquérir un logement car il est persuadé, qu’après l’acceptation du test obligatoire, tous les quartiers seront « marqués » et donc interdits aux marginaux comme lui.
Chaque court chapitre est consacré successivement à l’un des protagonistes. Des liens se tissent peu à peu entre eux mais la composition particulière du roman n’en favorise guère la lecture.
Après bien des péripéties, le dénouement consacre l’application obligatoire du test.
OLI, promoteur du projet, se retrouve seul, sa femme le quitte mais il est parvenu à ses fins.
Même TRISTAN, l’opposant radical, rentre dans le rang et passe le test.
Apparemment la société est dorénavant pacifiée dans la plus éprouvante des utopies.
L’Islande a créé le « meilleur des mondes » possible.
CONCLUSION
Le récit de Frida Isberg est implacable.
Les élites trouvent toujours de bonnes raisons pour imposer des règles liberticides à toute la population. Elles croient ainsi faire le bien des individus, malgré eux, en flattant le besoin de sécurité du plus grand nombre.
Les psychologues islandais ont atteint ce but, en toute bonne conscience, en rendant le test obligatoire. Ils sont intimement persuadés qu’ils se situent du bon côté, car eux respectent les codes. Ce sont bien sûr les « autres », les déviants, qui enfreignent les normes et qui doivent donc être isolés et guéris de leur « différence ».
Ne peut-on imaginer que ce n’est que lorsque les obligations feront entrer de plein pied la population dans la dictature, que la dissidence s’exprimera ?
Mais ne sera-t-il pas trop tard ?
Autres livres chroniqués dans la même rubrique thématique
SENSIBILITÉS | Tania DE MONTAIGNE
Fable sur notre temps, écrite en hommage à Salman Rushdie, la dystopie légère de Tania de Montaigne caricature à peine le présent. Les "réviseurs de texte" sont déjà à l'œuvre et l'attitude Feel Good se généralise alors que le monde s'embrase et que la violence progresse. L'auteure, directement concernée par le sujet et impliquée par la démarche puisqu'elle a du...
LirePANORAMA | Lilia HASSAINE
Le roman dystopique "Panorama" s'inscrit dans l'air du temps. Lilia Hassaine, journaliste et jeune autrice de talent, s'attaque au "Mantra" de l'époque, la Transparence et à son corollaire, la fin de toute vie privée. Elle renoue ainsi avec la grande tradition de " la maison de verre ", thème traité par Zamiatine, Huxley, Rand, Frank et bien d'autres. Symbolisée par...
LireL’EPIDEMIE | Asa ERICSDOTTER
Ce roman dystopique se situe dans un pays vierge de tout reproche apparent mais connu pour son passé hygiéniste. La Suède de l'autrice franchit le pas vers une de ses obsessions : la forme, le bien-être, la santé. Pour cela, il lui faut combattre l'ennemi d'où viennent tous les maux de la société, l'obésité. Publié en 2016, avant les pandémies...
LireLES BOUFFEURS ANONYMES | Marie ALINE
L'auteure, critique gastronomique renommée, centre d'abord son propos sur la cuisine, les addictions alimentaires, les nouvelles normes. Mais très vite, sa vision s'élargit et aborde l'exercice du pouvoir et ses dérives pour révéler des scènes déroutantes voire dérangeantes qui n'échappent pas toujours à une certaine complaisance. Cette dystopie culinaire est aussi une réflexion philosophique. Elle surprend, captive, interpelle et constitue...
LireCORPUS DELICTI, un procès | Juli ZEH
L’œuvre de J. Zeh, à l'écriture exigeante, prend une dimension très particulière dans les temps de pandémie traversés par la planète depuis 2020. Entre « Le meilleur des mondes » de A. Huxley, les sociétés sécuritaires asiatiques, les revendications toujours plus alarmistes des épidémiologistes en quête de pouvoir, CORPUS DELICTI annonce les dictatures sanitaires à venir.
LireLE PETIT POLEMISTE | Ilan DURAN COHEN
Dystopie ironique sur le monde qui vient, le roman de I. Duran Cohen n'hésite pas à forcer le trait et à revendiquer un ton satirique. Tous les engagements vertueux d'aujourd'hui, qu'ils témoignent du statut de la femme, des valeurs écologiques, de la place de l'animal sont devenus les cauchemars de demain.
Lire